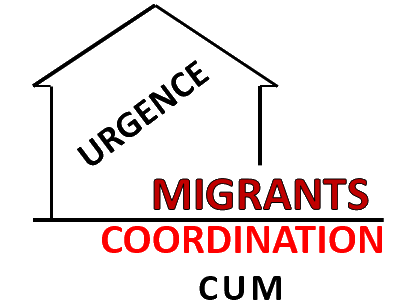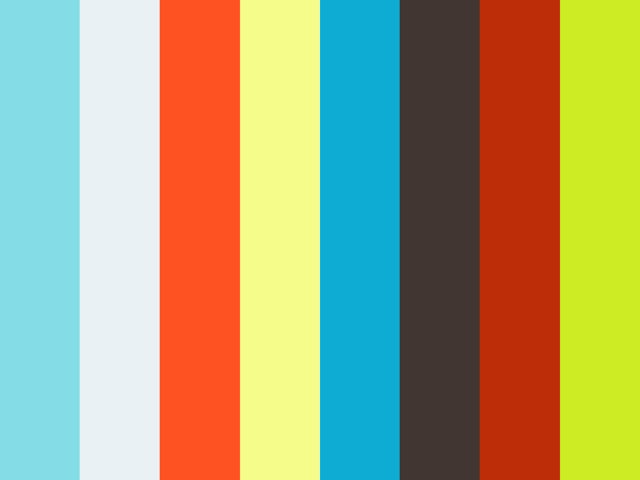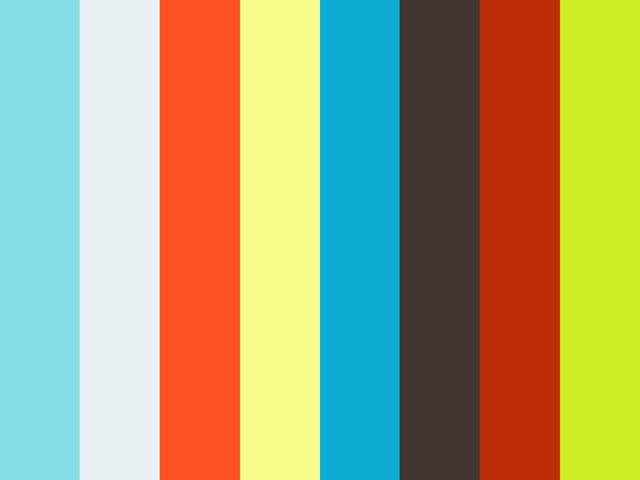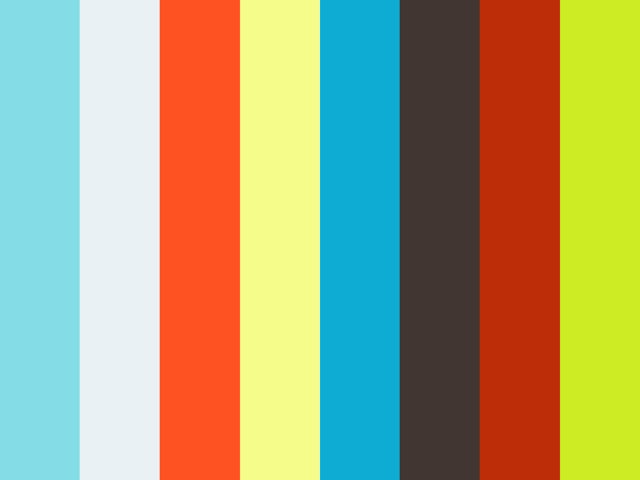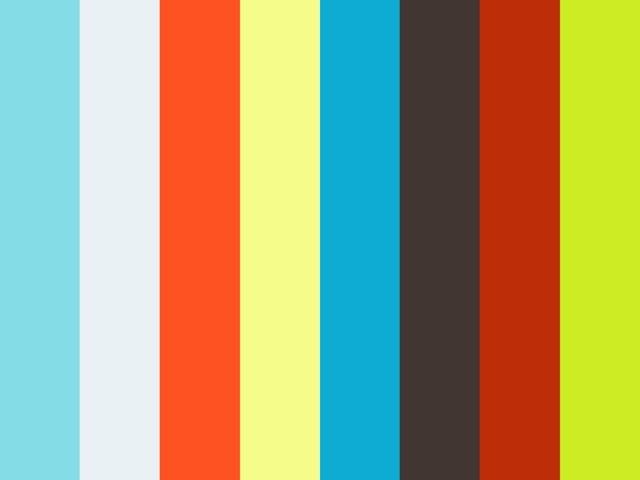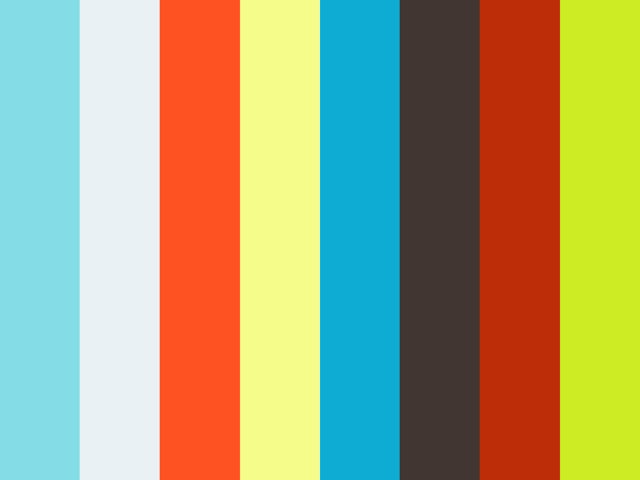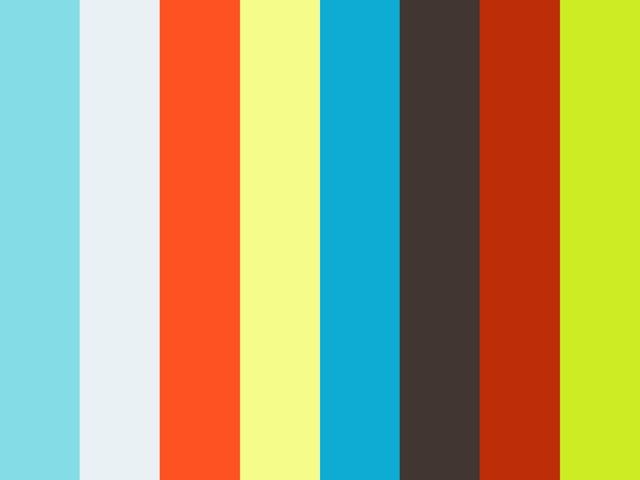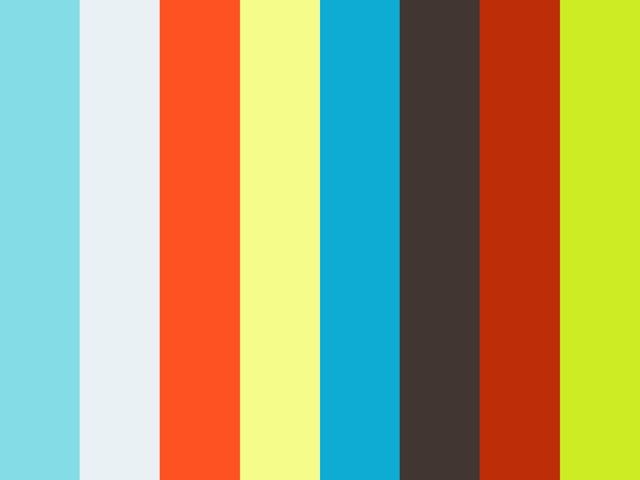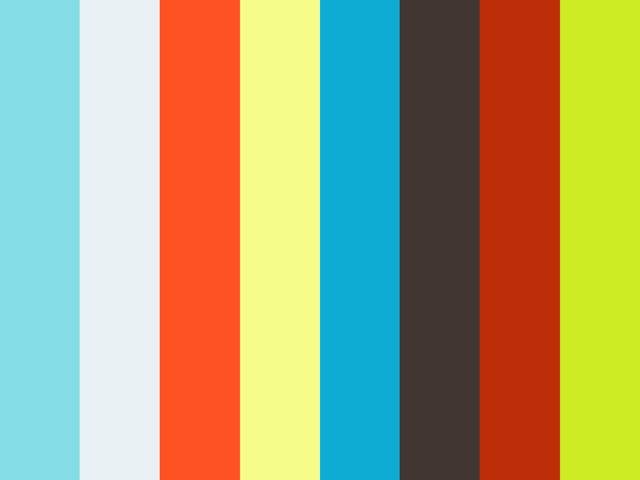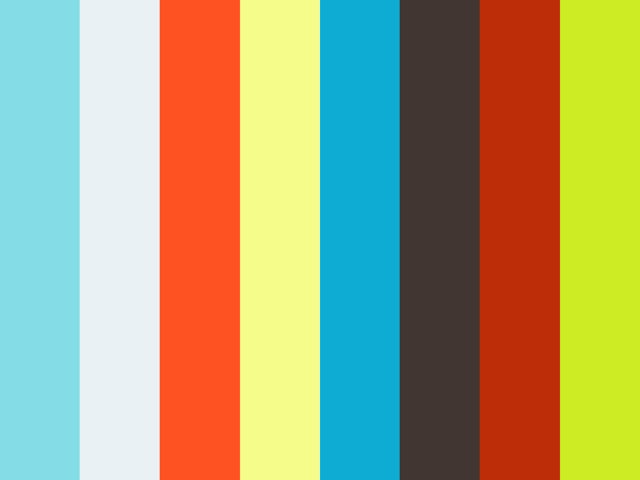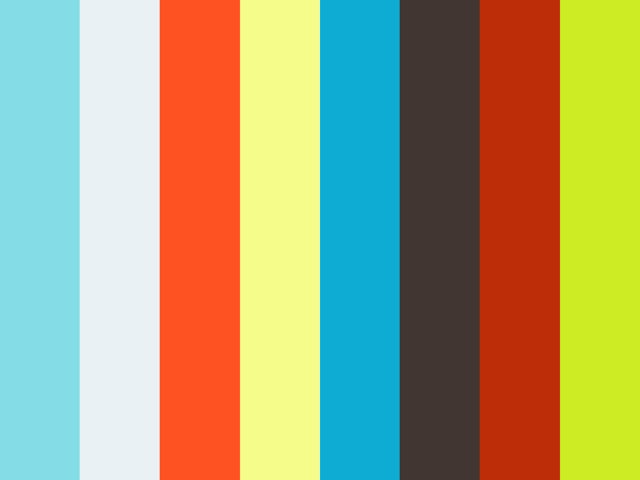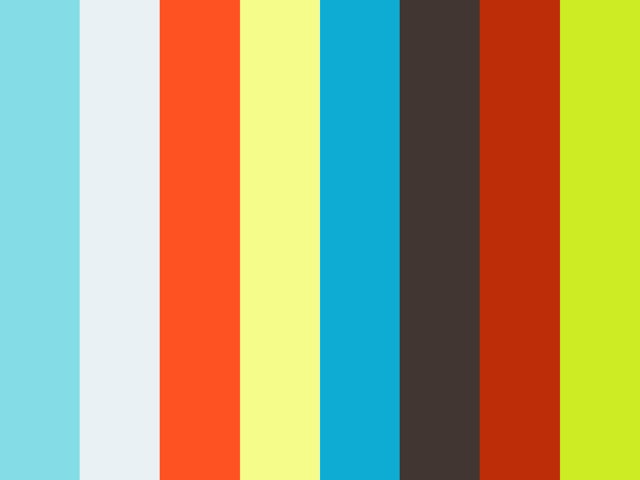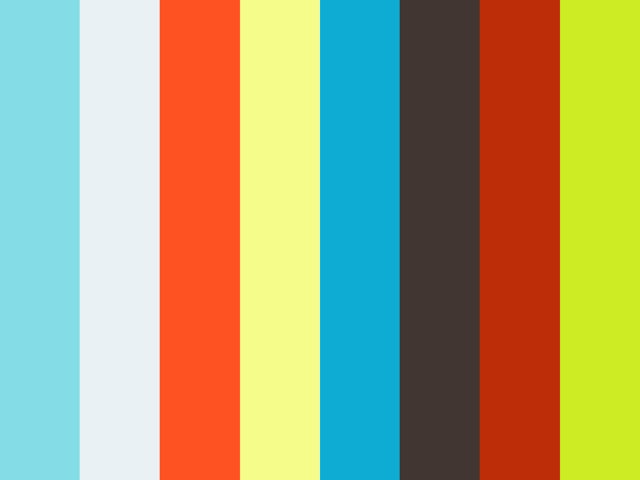Déboutés et déclassés
article extrait du Plein droit n° 105 - Juin 2015 - "Le naufrage de l'asile"
Par Nathalie Ferré
université Paris 13, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS)
Si le législateur s’intéresse aujourd’hui au débouté du droit d’asile, c’est pour lui dénier toute légitimité à rester en France et rendre plus efficace la mesure d’éloignement prise à son encontre. Privation subite du droit à hébergement, mesure de départ forcé avec procédure dérogatoire à la clé, possibilité de recours quasi inexistante : le demandeur d’asile débouté « doit quitter le territoire français ».
Le législateur s’est rarement intéressé aux demandeurs d’asile déboutés, au point qu’il s’avère difficile de les enfermer dans une catégorie juridique distincte, emportant un corpus de règles propres, qu’elles soient protectrices ou répressives. Une fois leur demande d’asile définitivement rejetée, ils deviennent, au fond, des sans-papiers comme les autres. Ni plus, ni moins. Peu importe qu’ils aient été candidats au statut de réfugié ; peu importe que cette procédure les ait encore plus fragilisés sur le plan psychologique ; peu importe les risques encourus vis-à-vis de leur pays d’origine du simple fait de leur demande ; peu importe que l’attribution du statut de réfugié soit aléatoire et que bon nombre de demandeurs d’asile, dans un autre monde et/ou à une autre époque, auraient sans doute bénéficié de la protection que garantit la convention de Genève.
Mais voilà, les déboutés du droit d’asile sont perçus comme des usurpateurs qui n’auraient pas dû entrer en France pour prétendre au graal. Les réformes en cours de l’asile et de l’immigration les rapprochent encore plus de cette condition de sans-droits. Pire, elles entendent les priver de recours effectif contre toute mesure d’éloignement. À l’heure où cet article est écrit, on ne sait pas encore ce qu’il adviendra des amendements adoptés par le Sénat, qui aggravent encore la situation des déboutés.
C’est ainsi que le législateur entend s’occuper des déboutés du droit d’asile : en leur déniant toute légitimité à se maintenir en France, il les prive des quelques droits restants au nom de l’efficacité de la mesure d’éloignement. En conséquence, il entend créer une nouvelle obligation de quitter le territoire quand « la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité [1] ». Outre cette mesure qui va immédiatement toucher la personne dont la demande de statut a été rejetée, le gouvernement veut aller plus loin en la soumettant à une procédure dérogatoire au droit commun de l’éloignement des étrangers indésirables. La personne aura ainsi seulement sept jours pour contester la décision d’éloignement (au lieu de trente jours pour le délai commun). Autant dire que, dans bon nombre de cas, les déboutés ne seront pas à même d’user de cette voie de recours, soit parce qu’ils auront été dans l’ignorance de ce délai (alors que l’obligation de quitter le territoire français les autorise à organiser leur départ volontaire pendant un mois, l’existence de ces deux délais différents pouvant être source de confusion), soit parce que, seuls, ils y auront renoncé… Sans oublier que le juge devra, de son côté, statuer dans les 30 jours, seul et sans rapporteur public [2]. L’objectif est clairement d’empêcher les déboutés de déposer une requête. Pour le législateur, leur recours est présumé « injustifié ». Les personnes n’étant pas légitimes à vivre en France lorsque leur demande d’asile a été refusée, l’efficacité de leur éloignement doit dès lors primer. Cette démonstration implacable n’est pas une vue de l’esprit ; elle ressort clairement de l’étude d’impact qui a précédé les réformes.
Péché
Lors du passage du projet de loi « asile » au Sénat, une partie des parlementaires a jeté son dévolu sur les déboutés et a souhaité anticiper sur ce futur dispositif, relevant de la réforme à venir du droit des étrangers. Selon la mesure adoptée, la décision définitive de rejet du statut de réfugié (par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – Ofpra ou, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile – CNDA, instance d’appel) vaudrait elle-même obligation de quitter le territoire français. On perçoit ce qu’ont en tête les sénateurs : les déboutés n’ayant plus de droit à demeurer en France, il est normal de leur notifier leur éloignement en même temps que le rejet de leur demande d’asile. Avec l’espoir que, dans la confusion, une partie substantielle d’entre eux n’exercent pas leur droit de recours contre la mesure d’éloignement dans les délais impartis.
Les demandeurs d’asile déboutés ont commis un péché, celui d’avoir choisi une voie royale qui s’est refermée. Les pouvoirs publics le leur reprochent implicitement par ce traitement défavorable. Déclassés, ils ne relèvent pas, d’ailleurs, du projet de loi « asile » mais du projet de loi « immigration » qui instaure, on vient de le voir, une mesure de départ forcé et une procédure dérogatoire à la clé. Dans son analyse commune portant sur la réforme de l’asile, la Coordination française pour le droit d’asile « déplore l’approche qui vise à disqualifier les demandeurs d’asile sur la seule base des refus de protection qui leur sont opposés par l’Ofpra et la CNDA » et regrette l’absence de prise en compte des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Pour autant, leur situation – ou plutôt leur nombre – a occupé pour partie les débats et les études qui ont précédé l’adoption, par le gouvernement, du projet de loi et son dépôt au Parlement, présenté comme l’aboutissement d’un processus de concertation réunissant des agents de l’administration, de la vie politique et judiciaire, et des représentants de plusieurs associations. Le rapport sur la réforme de l’asile, qui s’est ensuivi, piloté par deux parlementaires – Valérie Létard, sénatrice UDI du Nord et Jean-Louis Touraine, député PS du Rhône – et remis le 28 novembre 2013, annonce clairement la place donnée aux refusés de l’asile, dans une partie au titre évocateur « Prise en charge très insatisfaisante des personnes déboutées de leur demande d’asile, qui transforme la procédure d’asile en une voie d’immigration parmi d’autres ». Pour eux, le calcul est simple : avec un taux d’admission au statut de 22 % (en 2014), près de 80 % des exilés n’ont plus rien à faire en France puisqu’ils deviennent des étrangers en situation irrégulière (sous réserve de ceux et celles qui peuvent obtenir une carte de séjour à un titre autre). Et là, deux situations se présentent. Ou bien ils partent spontanément de France, avec la possibilité d’obtenir une aide au retour volontaire [3], mais ils ne sont guère nombreux. Ou bien ils sont éloignés de manière contrainte.
Si le rapport fait état d’un faible taux d’éloignement des déboutés – la remarque vaudrait aussi pour d’autres catégories d’étrangers sans-papiers –, les auteurs font observer le manque de données chiffrées, à défaut d’outils qui permettraient d’évaluer le nombre de départs forcés et volontaires.
Au fond, on ne sait rien ou presque des déboutés, si ce n’est lorsqu’ils ont eu la chance de bénéficier d’un hébergement durant la procédure. L’objectif étant alors de libérer des places dans le dispositif national d’accueil toujours saturé [4]. Ainsi, en 2012, sur les 7 000 déboutés (7 300 en 2014) sortis des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), 426 avaient opté pour une aide volontaire au retour. Dans l’étude d’impact qui a accompagné la réforme de l’asile, est mis en avant, pour le déplorer, le manque de cadre juridique sécurisé pour les procédures d’expulsion du dispositif national d’accueil. Les gestionnaires seraient ainsi amenés à « bricoler » ; le tribunal d’instance ne se considérant pas toujours compétent car il ne s’agit pas d’un bail ordinaire, il est recommandé de passer par le préfet pour obtenir la mise en demeure de l’« occupant indu » de quitter les lieux, et de saisir le juge administratif statuant alors en référé lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Ce conseil montre à quel point les refusés de l’asile ne sont appréhendés que sous l’angle de la contrainte et de la répression.
Le « déclassement » opéré produit ainsi deux effets majeurs : la privation subite d’un droit à hébergement (lorsque celui-ci a été effectif, ce qui est loin d’être toujours le cas) et la fin du droit au séjour.
Les déboutés du droit d’asile doivent ainsi quitter l’espace de vie qui leur avait été attribué en leur qualité de candidat au statut de réfugié. Ils ne pourront plus, si la loi est adoptée en l’état, accéder au dispositif d’hébergement d’urgence (CHRS notamment) considéré comme inadapté à leur situation puisque, n’ayant pas vocation à rester en France, il n’est pas question les concernant de parcours de réinsertion. La réalité n’est pas toujours aussi brutale et aveugle, mais l’intention des pouvoirs publics est claire : le fait de contraindre les personnes à quitter leur lieu d’hébergement et de ne leur donner aucune nouvelle perspective marque une rupture, un signe que la fin du droit au séjour est arrivée.
L’idée de « centres dédiés » aux déboutés qui auraient épuisé toutes les voies de recours, est apparue pour la première fois dans le rapport Létard-Touraine. Pour les inciter à s’y rendre, on envisage le versement d’une aide financière. Il s’agirait avant tout d’« accompagner » les personnes vers la sortie, sans recourir aux centres de rétention. S’ils ne sont pas présentés comme tels, les « centres dédiés » s’apparenteront bien à des lieux de privation de liberté.
Assigner pour éloigner
Ce dispositif, relativement coûteux pour l’État et qui fonctionne assez mal dans les pays européens où il existe, pourrait toutefois ne pas être mis en place dans la mesure où le projet de loi « immigration » propose un dispositif plus efficace en matière d’éloignement : priver les déboutés d’un recours effectif contre la mesure dont ils font l’objet. Si de tels centres n’apparaissaient pas dans le projet de loi initial, ils ont surgi sous la forme d’amendements déposés par l’opposition, après la fuite du rapport de la Cour des comptes [5]. Les sénateurs ont en effet prévu la possibilité d’assigner à résidence les déboutés « dans un lieu d’hébergement » où une aide au retour pourra leur être proposée. Il s’agit bien de donner une réalité juridique à la proposition évoquée dans le rapport Létard-Touraine. Lors des débats parlementaires, l’idée de bracelet électronique a également été évoquée.
Tout est pensé par ailleurs pour que les exilés qui n’ont pas obtenu le statut n’acquièrent pas de droit au séjour. L’accélération des procédures, quels que soient le gouvernement et la majorité en place, est la première solution préconisée. Le temps qui passe joue contre l’effectivité des mesures d’éloignement et offre, non pas forcément un droit, mais à tout le moins une chance ou l’espoir d’une régularisation : « Le fait de pouvoir espérer une régularisation à un autre titre que l’asile, malgré le rejet de la demande, de même que l’absence de mesures d’éloignement effectif et les durées de procédure à l’Ofpra et à la CNDA, sont des facteurs qui participent à écarter toute perspective de retour dans l’esprit de ceux qui sollicitent l’asile en France [6]. »
Il va sans dire que l’examen de la demande en des temps plus courts est, en soi [7], une bonne chose dès lors qu’il ne se fait pas au détriment de la qualité, mais il est toujours perçu de façon pragmatique et, dans le même temps, comme un des moyens d’empêcher les requérants de s’enraciner. Ce fut déjà la solution préconisée à la fin des années quatre-vingts où il fallait attendre des années avant d’obtenir une réponse, les dossiers s’accumulant jusqu’à produire l’engorgement de l’Ofpra et de l’instance d’appel. Une opération de désengorgement, qui allait s’intensifier à l’automne 1989, fut alors mise en place, consistant en l’examen à la chaîne de centaines de dossiers. Elle allait avoir pour effet de plonger dans la clandestinité des milliers de déboutés [8] et… d’obliger le gouvernement, sous la pression du monde associatif et grâce à la lutte de centaine de déboutés, à mettre en place une procédure collective de régularisation par voie de circulaire [9].
Selon le rapport Létard-Touraine, les accompagnements spécifiques des déboutés – dans et hors Cada – devraient comprendre une phase d’examen des possibilités de régularisation, mais rien dans le projet de loi « asile » ne le prévoit. Pire, le projet de loi « immigration » le contredit. Alors même que les déboutés sont placés dans une grande fragilité juridique et psychologique – violence des décisions de rejet, questionnement sur leur identité, risque d’arrestation et d’expulsion vers un pays où ils ne peuvent plus vivre –, ils ne bénéficient d’aucune écoute et sont le plus souvent de mauvais candidats à la régularisation. Certes, comme d’autres, ils peuvent, malgré les obstacles procéduraux [10], déposer une demande de titre de séjour [11], mais la durée de leur séjour en France – en moyenne, le débouté y aura passé deux ans, ce qui est peu comparativement à nombre de migrants postulant pour une régularisation – comme l’impossibilité juridique d’y travailler de façon légale, ne permettent pas d’espérer sérieusement une admission exceptionnelle au séjour au sens du code des étrangers [12]. Ils ne peuvent mettre en avant que leur « insertion sociale », tenant principalement à la scolarisation d’enfants.
Ni régularisables, ni expulsables
Aucune circulaire dite « de régularisation » ou « de réexamen de situations » de ces dernières années ne fait de la crainte d’un retour au pays d’origine un critère devant être pris en compte par les préfectures dans l’instruction des demandes de titre [13]. Il y a là un paradoxe car beaucoup de personnes concernées ne peuvent pas être éloignées du territoire français et reconduites vers leur pays d’origine en raison des risques qu’elles y encourent (soit du fait de la situation politique du pays, soit du fait des dossiers personnels suffisamment solides pour justifier ces craintes) par référence à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ainsi, il n’est pas rare que le juge administratif, quand il est saisi, annule la décision de renvoi vers le pays d’origine sans que les personnes reçoivent pour autant un titre de séjour. De la même façon, les préfectures renoncent généralement à renvoyer vers des pays en guerre, sur le fondement d’instructions ministérielles. Le dispositif global produit ainsi des « ni-ni », soit des personnes qui ne sont ni régularisables, ni expulsables. Celles-ci auraient dû, dans bien des cas, obtenir de l’Ofpra le régime de la protection subsidiaire – qui, rappelons-le devrait être accordé à celui ou à celle qui prouve être exposée à la peine de mort, à la torture, à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant, ou à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie en raison d’une violence généralisée, en cas de retour forcé. Ce sont en effet les mêmes raisons qui sont prises en compte par le juge pour annuler la décision fixant le pays de renvoi ou, implicitement, par l’administration lorsqu’elle renonce de fait à l’éloignement forcé.
Le Sénat a adopté, dans le cadre de la réforme du droit d’asile, une mesure qui résume à elle seule le traitement que l’on entend réserver aux déboutés : celui qui n’a pas obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire « ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et doit quitter le territoire français ». Jamais une telle disposition n’avait jusqu’alors été adoptée ni même sérieusement imaginée. Même s’il est probable qu’elle soit retirée lors du passage en commission paritaire, elle s’inscrit dans les esprits et prend date.
Notes
[1] Voir le 6° de l’article L. 511-1 du Ceseda, dans les termes prévus par le projet de loi relatif au droit des étrangers en France.
[2] Si l’intervention d’un rapporteur public ne garantit pas le succès de la demande d’asile, elle est le gage d’une audience non bâclée.
[3] L’aide au retour comprend une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage retour, la prise en charge des frais de réacheminement et une allocation forfaitaire (500 euros pour un adulte et 250 euros par enfant mineur).
[4] Voir l’article de Carolina Kobelinsky dans ce numéro de Plein droit. Ils représentent 7 % des personnes hébergées en Cada et sont considérés comme « en présence indue ».
[5] Le pré-rapport de la Cour des comptes, rendu public par Le Figaro en avril 2015, et les réactions qui s’en sont suivies, laissent à penser que l’idée de priver de liberté les déboutés de l’asile est partagée. La « mauvaise » prise en charge de ces derniers est considérée comme le vrai point d’achoppement du dispositif.
[6] Voir le rapport précité de Létard et Touraine.
[7] Le délai devrait passer à neuf mois sur injonction du droit communautaire.
[8] 100 000, selon le Réseau d’information et de solidarité (RIS), collectif informel rassemblant plusieurs associations parmi lesquelles la Cimade, la Pastorale des migrants, le Mrap, la Fasti, le Ciemi ou encore le Gisti. C’est le RIS qui portera l’action politique menée en faveur des déboutés.
[9] Les circulaires des 23 juillet, 14 août et 25 septembre 1991 ont permis de régulariser quelques milliers de déboutés (autour de 10 000 contre 100 000 personnes concernées). Voir « Une très exceptionnelle régularisation », Plein droit n° 15-16, novembre 1991.
[10] Pour ces déboutés de l’asile, tout s’enchaîne très vite, le rejet de la demande de statut entraînant le retrait du récépissé. En conséquence, déposer une demande de séjour durant cette période de bouleversement et d’instabilité s’avère périlleux.
[11] Nous laissons de côté les hypothèses où la situation personnelle et/ou familiale du débouté le met en situation de prétendre à une carte dite « vie privée et familiale » en tant que conjoint⋅e de Français·e ou du fait de sa santé.
[12] Article L. 313-14 du Ceseda.
[13] Les circulaires évoquées de 1991 y faisaient référence, la circulaire dite « Pandraud » du 5 août 1987 également.