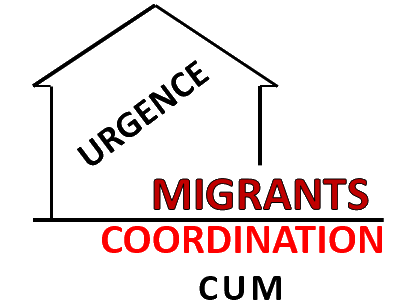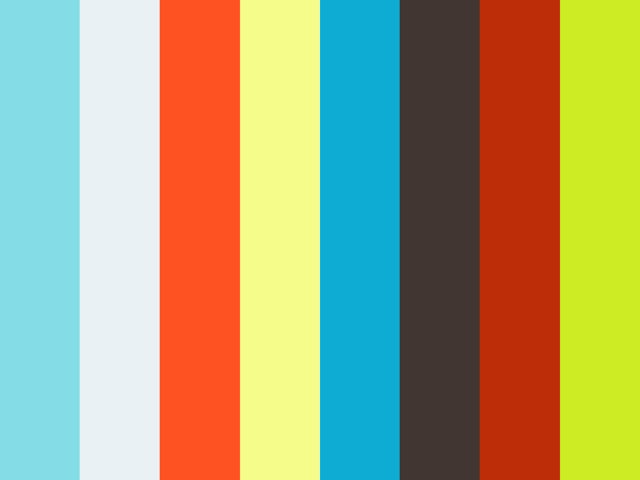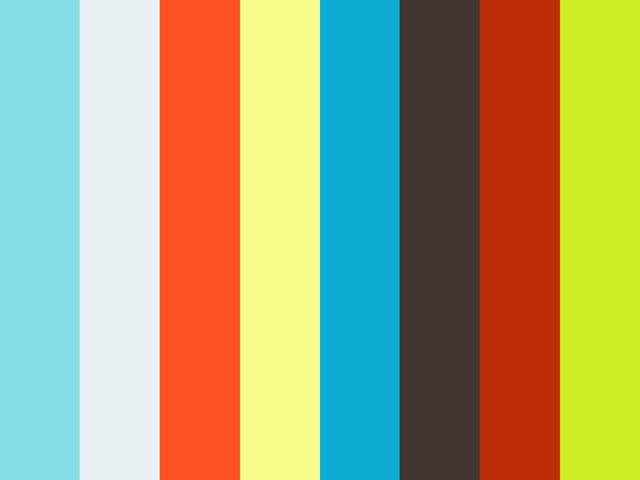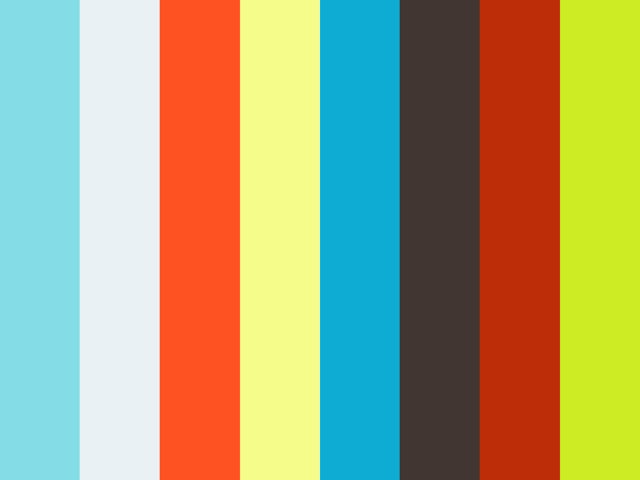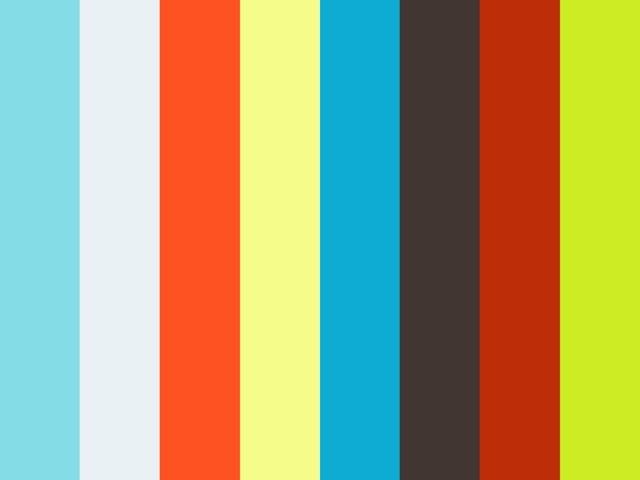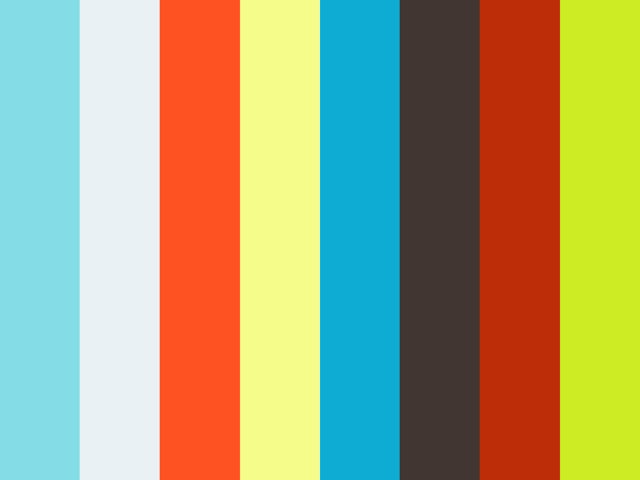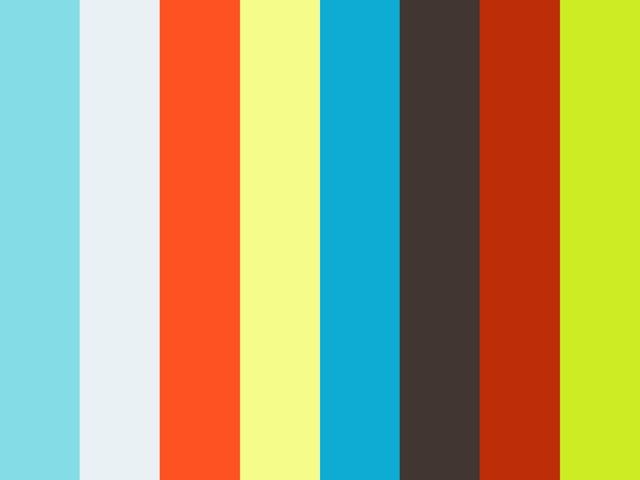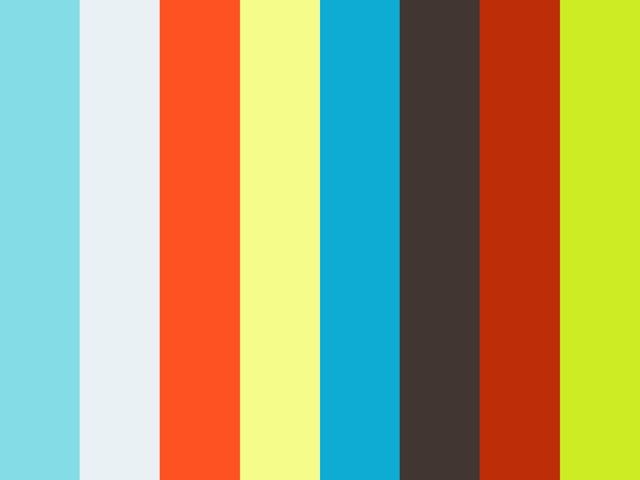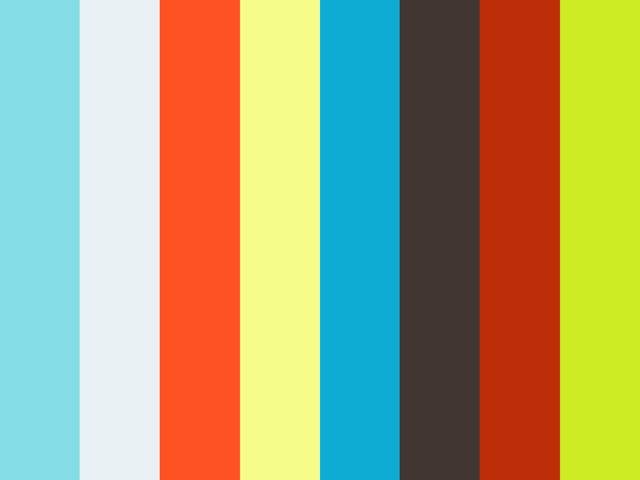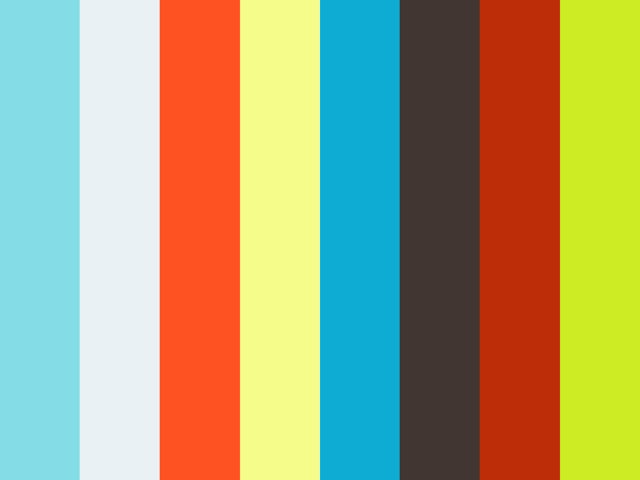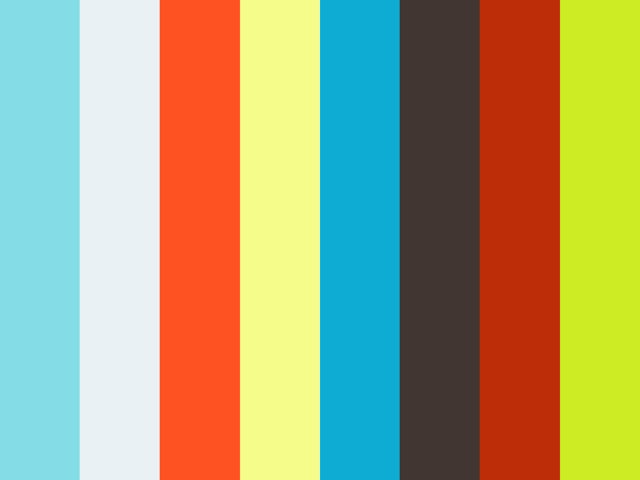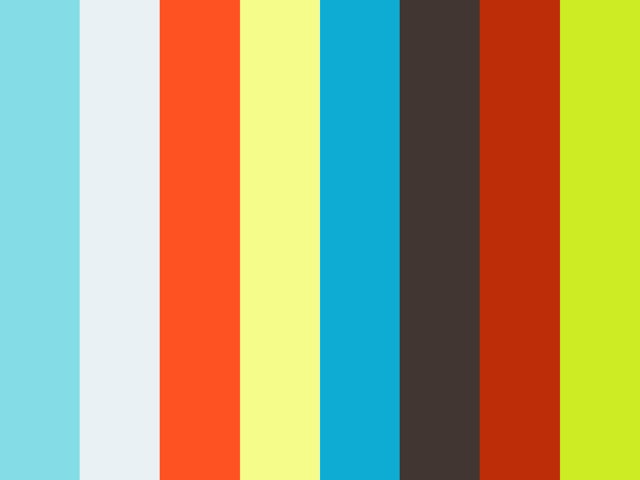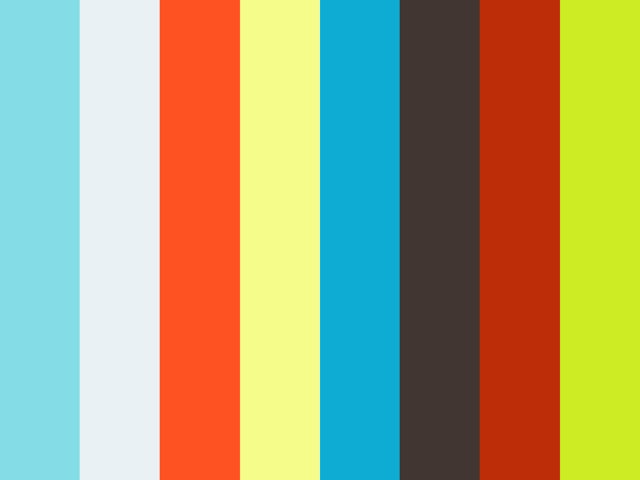Voir Calais et mourir - GITSI - revue Plein droit N° 109
Maël Galisson - Militant, ex-coordinateur de la Plate-forme de services aux migrants (PSM)
Maël Galisson
Militant, ex-coordinateur de la Plate-forme de services aux migrants (PSM)
Si, depuis quelques années, militants et chercheurs commencent à compter les morts sur les routes migratoires, ils ont tendance à se focaliser sur l’arc méditerranéen, négligeant la frontière franco-britannique que l’on pourrait qualifier de nasse calaisienne. Accords européens, traités bilatéraux et leurs corollaires sécuritaires font en effet de cette frontière un mur meurtrier. Et les migrants n’ont d’autre choix que de prendre toujours plus de risques pour le franchir… au péril de leur vie.
Nawall Al Jende avait 26 ans. Elle était originaire de Nawa, une ville située à une trentaine de kilomètres de Deraa, dans le sud de la Syrie. Elle avait fui la guerre et laissé derrière elle son époux et deux de ses enfants. Avec son troisième enfant, Mohamed, âgé de 9 ans, et le frère de son mari, Oussama, son périple l’avait amenée à traverser neuf pays avant d’atteindre Calais. Sa sœur, Sawson, avait réalisé un parcours quasi similaire deux mois plus tôt et l’attendait de l’autre côté de la Manche. Nawall est décédée le 15 octobre 2015, après avoir été percutée par un taxi sur l’autoroute A16, alors qu’elle tentait de se glisser dans un camion afin de franchir la frontière franco-britannique. Comme sur les autres routes de l’exil, des personnes migrantes meurent à Calais et dans sa région. Depuis 1999, on estime qu’au moins 170 personnes sont décédées en tentant de franchir cet espace frontalier reliant la France à l’Angleterre.
Pourquoi prêter attention aux personnes mortes en migration à la frontière franco-britannique ? Il n’existe pas de données officielles à ce sujet. Par conséquent, participer au travail de collecte d’informations contribue à documenter l’histoire du fait migratoire dans la région. En l’espace de quelques années, la question des exilés morts aux frontières s’est imposée dans le débat public. Elle a été d’abord portée, par des acteurs militants, à l’image des travaux réalisés parUnited for Intercultural Action, Fortress Europe ou encore Watch the Med. Puis, des journalistes se sont intéressés au sujet (The Migrants Files), ainsi que des chercheurs (Deaths at the Borders Database). Aujourd’hui, une institution officielle telle que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) commence à recenser les personnes mortes en migration. Toutefois, dans ces différents relevés, la situation à la frontière franco-britannique est peu prise en compte, le focus étant davantage dirigé sur la mortalité aux portes de l’Europe, dans l’arc qui va des Iles Canaries à la mer Égée, en passant par le détroit de Gibraltar et le canal de Sicile. Par conséquent, travailler à la collecte d’informations sur les personnes mortes à Calais et dans la région répond à un réel besoin et rend visible une réalité méconnue.
Redonner un nom aux morts
Ce travail d’enquête ne veut pas s’en tenir au traitement simplement comptable ou anecdotique de la question des morts en migration. Il cherche, quand cela est possible, à redonner une identité et une histoire à ces « corps sans nom » ou à ces « noms sans histoire ». Tenter de reconstituer des récits de vie, (re)donner une dimension personnelle à chaque décès est un moyen d’éviter leur dilution dans ce qu’on nomme communément, de façon globalisante, les « drames de la migration ». Il s’agit également de rompre avec l’idée que cette hécatombe résulterait de la fatalité. Réduire ces tragédies à des accidents (accident de la route, noyade, etc.), à des violences ou des règlements de compte entre migrants est une façon d’occulter la responsabilité des pouvoirs publics dans une situation qui dure depuis plus de vingt ans dans le nord de la France. Au contraire, c’est bien l’addition d’accords européens et de traités bilatéraux, destinés à empêcher les indésirables d’accéder au territoire britannique qui a fait de cette région un mur meurtrier. De même, considérer que les seules violences exercées à l’encontre des exilés sont dues aux « réseaux de passeurs » est une manière d’occulter celles qui sont liées aux conditions de vie et à l’absence de dispositifs d’accueil adaptés, au harcèlement policier et à la surenchère de dispositifs de surveillance de la frontière.
On constate en effet que la majorité des décès sont liés aux tentatives de passage, qu’ils soient immédiats ou qu’ils surviennent des suites de blessures que ces tentatives occasionnent. Le long de la frontière franco-britannique, les exilés meurent principalement après avoir été percutés par un train sur le site d’Eurotunnel, renversés par un véhicule – parfois volontairement – sur un axe routier non loin d’un point de passage ou écrasés sous l’essieu d’un poids lourd. Et finalement, les « règlements de compte » ou les violences « inter ou intra-communautaires » se concluant par des morts restent des événements marginaux.
La majeure partie des exilés tentent de passer la frontière cachés dans la remorque d’un camion ou en dessous. Cette méthode s’avère extrêmement dangereuse et les risques de mourir écrasé par le contenu de la marchandise, par suffocation ou en tombant du camion (en particulier une fois arrivé sur le territoire britannique) sont importants. On pense notamment aux 58 personnes migrantes de nationalité chinoise cachées dans un camion frigorifique et découvertes mortes par asphyxie à Douvres en juin 2000. Un événement qui fait terriblement écho à la tragédie survenue 15 ans plus tard en Autriche, quand 71 exilés syriens cachés dans un camion furent abandonnés sur le bord d’une autoroute par le conducteur et décédèrent par suffocation.
Même si le phénomène reste minoritaire, on recense plusieurs cas de noyades. Si quelques-unes se sont produites à la suite de rixes ou afin d’échapper à des violences policières, la plupart sont survenues pendant des tentatives de franchissement de la frontière. On observe ainsi plusieurs cas désespérés, et finalement mortels, survenus lors de la traversée du détroit du Pas-de-Calais, par embarcation ou à la nage. Le 12 juin 2002, un exilé russe parti en canoë s’est noyé dans la Manche. Son corps n’a jamais été retrouvé et le camarade qui l’accompagnait est resté accroché pendant cinq heures à l’embarcation à la dérive avant d’être secouru. Le précieux travail d’investigation du journaliste norvégien Anders Fjellberg [1] a permis de retracer le parcours de deux exilés syriens, Mouaz Al Balkhi et Shadi Omar Kataf. Après plusieurs semaines passées entre les Jungles de Calais et de Grande-Synthe et une douzaine de tentatives de passage « classiques » ratées, les deux compatriotes optèrent pour une autre stratégie. Le 7 octobre 2014, ils se procurèrent une combinaison de plongée au magasin Décathlon de Calais. Leurs corps ont été retrouvés quelques semaines plus tard, l’un sur une plage de Norvège, l’autre sur une plage des Pays-Bas.
Petits arrangements entre voisins
Les modes de franchissement de la frontière évoluent en fonction de son niveau de sécurisation. Plus un point de passage est rendu inaccessible, plus il y a de prises de risque et plus ces tentatives impliquent le recours à un « tiers », le passeur. En septembre 2014, le ministre de l’intérieur français, Bernard Cazeneuve, signait avec son homologue britannique, Theresa May, un accord bilatéral « incluant une contribution britannique de 5 millions d’euros par an pendant trois ans » dont l’une des mesures principales visait à « renforcer la sécurité, à la fois autour du port et dans la zone portuaire [2] ». Cet accord visait à empêcher, d’une part, les tentatives d’intrusions collectives sur le site portuaire et, d’autre part, les incursions sur la rocade accédant au port, technique consistant à profiter des embouteillages pour se cacher dans la remorque d’un camion La mise en œuvre du versant « sécurisation » de cet accord a été confiée à l’entreprise Zaun, une firme britannique [3], et s’est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, à partir d’octobre 2014, les barrières ont été doublées à l’intérieur du site portuaire. Puis, au printemps 2015, sur une distance de deux kilomètres le long de la rocade accédant à la zone portuaire, a été érigée une double clôture, l’une de 4 mètres de haut et l’autre d’un peu moins de 3 mètres, équipée d’une rampe d’accès incurvée pour éviter qu’on ne s’y s’agrippe, et surmontée d’un fil barbelé. Entre les deux clôtures, un espace de détection infrarouge a été installé. La mise en place de cet arsenal autour de la zone portuaire a obligé les exilés à se détourner du port pour trouver d’autres voies de passage, plus dangereuses, notamment celle du tunnel sous la Manche. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : alors qu’aucun des 17 décès recensés en 2014 n’avait eu lieu sur le site d’Eurotunnel, on en comptait 15 sur les 25 enregistrés en 2015. Il serait difficile d’en conclure que plus on boucle la frontière franco-britannique, plus celle-ci devient meurtrière. En effet, l’augmentation significative du nombre de morts entre 2014 et 2015 s’explique aussi par celle du nombre d’exilés présents dans le Calaisis. Les militants locaux estiment qu’il a crû, en un an, de 1 500 à environ 5 000 personnes. Il est en revanche certain qu’à la multiplication des barrières et des dispositifs dissuasifs, se sont ajoutées les désastreuses conditions de vie des exilés, obligés de survivre dans une extrême précarité et dans un contexte de surpopulation croissante, tout en tentant d’échapper aux violences policières : un cocktail explosif qui les a poussés plus nombreux à prendre des risques pour espérer passer. En août 2015, un nouvel accord franco-britannique fut signé dans lequel les deux ministres reconnaissaient que « depuis la fin du mois de juin, en raison de la sécurisation du port, les migrants ont changé de stratégie, cherchant au péril de leur vie, à s’introduire au niveau des points d’entrée dans le tunnel sous la Manche ». Mais qu’imaginent-ils pour remédier à ce constat inquiétant ? Que « la France renforce l’actuel dispositif de sécurité et l’action de ses policiers et de ses gendarmes, grâce au déploiement d’unités mobiles additionnelles » et que le Royaume-Uni alloue des moyens supplémentaires pour « sécuriser le périmètre de l’entrée du tunnel, grâce à un dispositif de clôtures, de vidéosurveillance, de technologie de détection infrarouge et de projecteurs lumineux » tout en « [aidant] la société Eurotunnel à augmenter nettement ses effectifs en charge de la sécurité et de la protection du site [4] ». Ce qui s’est traduit par l’installation de 29 kilomètres de nouvelles barrières et le « renforcement » de 10 kilomètres déjà existants. Le paysage du site d’Eurotunnel a été radicalement bouleversé : 100 hectares ont été rasés afin de faciliter la surveillance et une partie de cette zone a été volontairement inondée « pour créer des obstacles naturels qui empêchent l’accès aux clôtures » [5].
Fortification
Cette séquence n’est finalement qu’une étape supplémentaire dans la longue histoire de la fortification de la frontière franco-britannique. Elle a commencé avec le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) régissant les zones portuaires fournissant des services internationaux et s’est prolongée, depuis le début des années 1990, par une succession d’accords bilatéraux. Alors que le protocole de Sangatte (1991) avait initié la mise en place de contrôles juxtaposés français et britanniques des deux côtés de la frontière, son protocole additionnel (2000) les a étendus aux principales gares du nord de la France et du sud de l’Angleterre.
Au tournant des années 2000, la fortification de la frontière prend une autre dimension. Du côté du site portuaire, « en 2000, un premier programme de 6 millions d’euros est engagé pour clôturer une partie du port, installer un réseau de vidéo surveillance ainsi qu’un bâtiment spécifique au département sûreté ». Jusqu’alors, la zone portuaire n’était que très sommairement clôturée. « À partir de 2005, un deuxième programme d’investissement de 7 millions d’euros est engagé […] [permettant] de finaliser l’année suivante, un réseau de 48 caméras fixes et mobiles de vidéo surveillance [6]. » De son côté, Eurotunnel renforce la surveillance de son site à partir du printemps 2001 et bénéficie, en février 2002, du prêt d’un radar PMMW (système à détection thermique) de l’armée britannique. Tandis que la signature du traité du Touquet (2003) étend les dispositions relatives aux contrôles juxtaposés à tous les ports de la Manche et de la mer du Nord, « l’arrangement » franco-britannique de 2009 accentue le recours aux dispositifs de détection et crée un centre de coordination conjoint « chargé de recueillir et partager toutes les informations nécessaires au contrôle des biens et de personnes circulant entre la France et le Royaume-Uni » [7]. Les accords franco-britanniques de 2014 et 2015 sont venus compléter cet empilement de textes.
Retracer de manière précise et tenter de cartographier l’évolution des dispositifs mis en place autour de la frontière franco-britannique n’est pas chose aisée. En effet, l’accès à l’information est relativement restreint, du fait notamment de la multiplicité des acteurs impliqués (services de l’État, gestionnaires des sites portuaires et du tunnel, prestataires de sécurité privés, etc.) et du manque de transparence qui en résulte. Dans ses déclarations, le porte-parole d’Eurotunnel indique que « depuis l’apparition des clandestins [sic] dans le Calaisis, Eurotunnel a, au-delà de ses obligations contractuelles, investi massivement dans les moyens physiques (clôtures, éclairages, caméras, barrières infrarouges) et humains de protection du terminal de Coquelles : plus de 160 millions d’euros, dont 13 millions d’euros au premier semestre 2015 » [8]. Difficile d’évaluer finement ce que coûte cette surenchère. Cette question fait l’objet d’une bataille de communication, notamment entre l’État et Eurotunnel, le premier reprochant au second de ne pas en faire assez en matière de sûreté tandis que le second réclame toujours plus d’aides pour protéger le site. L’affaire, connue sous le nom de « contentieux de Sangatte », s’est d’ailleurs conclue devant les tribunaux en 2003 par une victoire d’Eurotunnel qui a obtenu de la France et de la Grande-Bretagne une indemnisation pour les investissements qu’il avait consentis à cet effet [9].
Du coût humain, il n’en est bien entendu pas question. Aux morts recensées s’ajoutent celles qui n’ont pu l’être. Par manque de sources, car « il y a suffisamment à faire avec les vivants [10] » ou par oubli tout simplement. Et puis il y a les personnes blessées, « des jeunes aux mains et aux jambes lacérées par les barbelés qui entourent le site d’Eurotunnel […] ces clôtures [qui] déchiquettent la peau de manière anarchique [11] ». Mutilées ou accidentées, ces personnes n’entrent dans aucun décompte. Le 21 octobre 2001, dans La Voix du Nord, la journaliste Sophie Leroy titrait son article « Assez de mort aux frontières » [12] en reprenant l’un des slogans de la manifestation organisée à Calais par le collectif C’Sur [13] pour dénoncer cette frontière meurtrière. Quinze années plus tard, la liste des morts n’a cessé de s’allonger.
Extrait du Plein droit n° 109
« Homicides aux frontières »
(juin 2016, 10€)
Vous pouvez commander cette publication auprès du Gisti
(règlement par chèque, carte bancaire ou virement)
Plein droit, la revue du Gisti
www.gisti.org/pleindroit
[ Articles à l'unité / Abonnements / Librairies ]